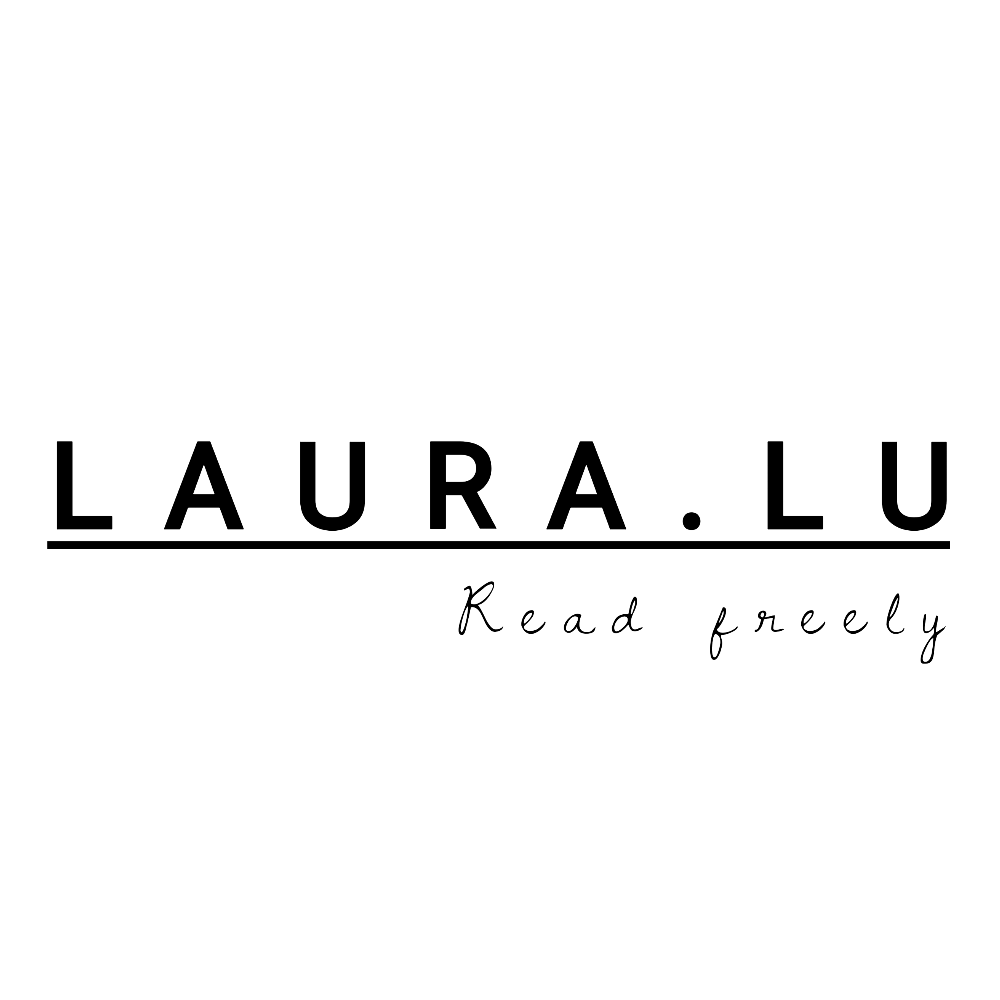En août, la peste a atteint son paroxysme: c'est à ce sommet de la maladie que le narrateur nous décrit la situation générale à Oran à travers les violences de ces concitoyens vivants, les enterrement des défunts et la souffrance des amants séparés.
Les violences
A présent, la peste a aussi gagné le centre-ville et les Oranais sont à fleur de peau. Certaines personnes qui reviennent de leur quarantaine sont « affolées par le deuil et le malheur, mett[ent] le feu à leur maison dans l'illusion qu'elles y f[ont] mourir la peste. On a beaucoup de mal à combattre ces entreprises dont la fréquence soumet des quartiers entiers à un perpétuel danger en raison du vent violent. » (p.175) Voilà pourquoi on menace les incendiaires de peines très sévères. « Et sans doute, ce n'était pas l'idée de la prison qui fit reculer ces malheureux, mais la certitude commune à tous les habitants qu'une peine de prison équivalait à une peine de mort par suite de l'excessive mortalité qu'on relevait dans la geôle municipale. » (p.175) En effet, la vie en communauté signifie une menace réelle en temps d'épidémie. Voilà pourquoi on fait loger les moines des deux couvents dans des familles religieuses et les soldats dans des écoles ou des immeubles publics. « Ainsi la maladie qui, apparemment avait forcé les habitants à une solidarité d'assiégés, brisait en même temps les associations traditionnelles et renvoyait les individus à leur solitude. Cela faisait du désarroi. » (p.176)
Qui plus est, de petits groupes armés s'attaquent à nouveaux aux portes de la ville la nuit. On tire alors sur les fugitifs: il y a des blessés et certains réussissent à s'évader. Mais, vu qu'on renforce les postes de garde, on met rapidement fin à ces actes de révolte.
On assiste aussi à d'autres actes d'une violence inouïe. Des gens jusque-là honorables se mettent à piller des maisons qui sont en flammes ou qui ont été fermées pour des raisons sanitaires. Les autorités réagissent en assimilant l'état de peste à l'état de siège. On fusille deux voleurs, « mais il est douteux que cela fait impression sur les autres, car au milieu de tant de morts, ces deux exécutions passent inaperçues. Des scènes semblables se renouvellent assez souvent sans que les autorités font mine d'intervenir. La seule mesure qui semble impressioner tous les habitants est l'institution du couvre-feu ». (p.177)
Les enterrements
Au début, la rapidité est un des signes caractéristiques des enterrements. Pour cela, les formalités ont été simplifiés.
Les malades meurent loin de leur famille et on a interdit les veillés funèbres. Si on meurt dans la soirée, on passe la nuit tout seul et si on meurt dans la journée, on est tout de suite enterré. La famille est avertie, mais si elle est placée en quarantaine, elle ne peut pas venir. Si elle peut venir, elle se présente à l'heure fixée pour le départ pour le cimetière et le cercueil est déjà fermé. Le chef de famille signe les papiers, on charge le corps soit dans une voiture qui est un vrai fourgon soit dans une grande ambulance transformée, la famille monte dans un taxi et on rejoint rapidement le cimetière par des rues extérieures. A la porte, des gendarmes tamponnent le laissez-passer et on entre sur le site où un prêtre attend, car il n'y a plus de services funèbres à l'église. La bière est rapidement mise en terre pendant qu'on prie. L'ambulance est déjà partie pour l'arrosage désinfectant et la famille repart avant même que le cercueil ne soit entièrement enterré. « Ainsi tout se passait vraiment avec un maximum de rapidité et le minimum de risques. » (p.180) Vu les circonstances, on ne peut pas tenir compte des considérations, ils avaient tout sacrifié à l'efficacité.
Quand l'épidémie se développe encore davantage, les cercueils se font plus rares, on manque de toile pour coudre des linceuls et il n'y a pas assez de place au cimetière. On groupe alors les cérémonies et, s'il le faut, on multiplie les voyages entre l'hôpital et le cimetière: on remplit donc les cercueils qu'on a, on transporte les corps au cimetière, vide les cercueils dans un hangar, les désinfecte et on retourne charger des corps. Cette organisation est donc très eficace. A présent, on enterre même les corps dans deux immenses fosses, une pour les hommes, une pour les femmes. Plus tard, aux dernières heures du fléau, on enterre pêle-mêle, les uns sur les autres, hommes et femmes, sans souci de la décence.
Le risque de mourir de la peste quand on est infirmier ou fossoyeur est certain. Malgré tout, il y a toujours des candidats pour ces postes, même s'il y a une période critique peu avant que la peste n'atteigne son sommet.
Avec le nombre de morts qui va toujours croissant, le cimetière finit par être saturé. Pour remédier à l'accumulation des morts, on évacue, de façon anonyme, d'abord plus rapidement et plus pragmatiquement les cadavres. (p.182)
Un peu plus tard cependant, il faut conduire les morts de la peste eux-mêmes à la crémation. (pp.183-184) Comme les habitants de certains quartiers se plaignent des odeurs désagréables et menacent de déserter, les fumées doivent être détournées par un système de canalisations compliquées afin de calmer les Oranais.
Vu l'accumulation des cadavres, la municipalité doit organiser les funérailles: la peste est devenue une administration. Vu l'omniprésence du fléau, cette administration l'emporte. Il n'y a plus de place ni pour les rites, ni pour la réflexion, ni pour la méditation, ni pour l'émotion. L'homme a perdu toute dignité. Il s'agit de débarrasser la cité au plus vite des corps des pestiférés, sans se soucier de la personne humaine.
Cette organisation méticuleuse et cette absence de toute sensibilité humaine nous renvoient aux camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale.
La souffrance des amants séparés
Ces conditions font que les Oranais souffrent encore davantage de l'exil et de la séparation: « rien n'est moins spectaculaire qu'un fléau et, par leur durée même, les grands malheurs sont monotones ». On pourra donc dire que la souffrance elle-même perd de son pathétique. Non que les amants séparés se soient habitués à la situation et aient trouvé un moyen de gérer leur nostalgie, mais au moral comme au pyhsique, ils souffraient de décharnement.
« Au début de la peste, ils se souvenaient très bien de l'être qu'ils avaient perdu et ils le regrettaient. [...] En somme, à ce moment-là, ils avaient de la mémoire, mais une imagination insuffisante. Au deuxième stade de la peste, ils perdirent aussi la mémoire. [...] Tout au bout de ce long temps de séparation, ils n'imaginaient plus cette intimité qui avait été la leur, ni comment avait pu vivre près d'eux un être sur lequel, à tout moment, ils pouvaient poser la main. » (p.186)
Tout le monde éprouve des sentiments monotones. Les Oranais sont certes abattus, mais pas résignés: pourtant ils vivent dans une sorte de consentement provisoire et ils se sont adaptés. «Le docteur Rieux, par exemple, considérait que c'était cela le malheur, justement, et que l'habitude du désespoir est pire que le désespoir lui-même.» A présent, même les amants séparés ont l'oeil si ennuyé que, grâce à eux, toute la ville rassemblait à une salle d'attente. (p.187)
« Pour la première fois, les séparés n'avaient pas de répugnance à parler de l'absent, à prendre le langage de tous. [...] Alors que, jusque-là, ils avaient soustrait farouchement leur souffrance au malheur collectif, ils acceptaient maintenant la confusion. Sans mémoire et sans espoir, ils s'installaient dans le présent. [...] Il faut bien le dire, la peste avait enlevé à tous le pouvoir de l'amour et même de l'amitié. Car l'amour demande un peu d'avenir, et il n'y avait plus pour nous que des instants. » (p.187)
Si, au début de la peste, les amants séparés vivaient une existence privilégiée, puisque l'amour les sauvait de la panique, « ils ne s'intéressaient qu'à ce qui intéressait les autres, et ils n'avaient plus que des idées générales et leur amour même avait pris pour eux la figure la plus abstraite. [...] Ils n'avaient l'air de rien. Ou, si on préfère, ils avaient l'air de tout le monde, un air tout a fait général. [...] On peut dire pour finir que les séparés n'avaient plus ce curieux privilège qui les préservait au début. Ils avaient perdu l'égoïsme de l'amour, et le bénéfice qu'ils en tiraient. Du moins, maintenant, la situation était claire, le fléau concernait tout le monde. » (pp.188-189) Et le narrateur conclut: « Notre amour sans doute était toujours là, mais, simplement, il était inutilisable, lourd à porter, inerte en nous. » (p.190)
Voici la fin de la IIIe partie.
(cf. voir La Peste a une signification historique. Expliquez et illustrez. )